INTERVIEW
Joëlle Cattino · Metteuse en scène
BONJOUR JOËLLE, POUR COMMENCER POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER ?
Je m’appelle Joëlle Cattino, et je suis metteuse en scène ainsi que directrice artistique de la compagnie Dynamo Théâtre, que j’ai fondée en 2009. Avant ça, j’ai été comédienne pendant de nombreuses années, et c’est vers mes 30 ans que j’ai commencé à me tourner vers la mise en scène et la direction d’acteurs. J’ai travaillé pour plusieurs compagnies, en tant qu’associée sur leurs projets de recherche.
Depuis toujours, je suis très attirée par les écritures contemporaines, surtout celles qui abordent des questions sociétales importantes. C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’avec Michel Bellier, nous avons entamé un véritable dialogue sur la possibilité de mettre nos recherches en commun, dans un cadre qui nous serait propre.
De là est née notre propre structure de production et de création, qui a permis la naissance de nombreux spectacles depuis 2010. La plupart sont basés sur les écritures de Michel, mais pas uniquement. Nous avons aussi commandé des textes à d’autres auteurs et autrices, parfois en leur proposant de mélanger leurs écritures. Cela a donné lieu à des spectacles en plusieurs parties, ou à des recherches plus hybrides sur la fusion des styles. En ce moment, par exemple, nous travaillons avec des auteurs et autrices venus du Québec, de Belgique et de Guadeloupe pour réfléchir à l’évolution de l’écriture théâtrale francophone.
Avec Michel, nous avons toujours eu à cœur de travailler avec le public, qu’il soit jeune ou moins jeune. On aime l’idée de faire connaître nos recherches, de créer des échanges avec les spectateurs. Cela passe souvent par des ateliers ou des stages, notamment en collaboration avec la FNCTA.
Nous venons tous les deux de l’éducation populaire des années 70-80, ce qui a fortement influencé notre formation et notre approche de l’art théâtral, avec une éthique bien précise et une vision de ce que doit être le théâtre.

QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS QUI VOUS A AMENÉ VERS LA MISE EN SCÈNE ?
Le théâtre m’a toujours passionnée sous toutes ses formes. J’étais autant sur le plateau qu’en spectatrice, observant mes collègues et m’interrogeant sur la façon dont chacun abordait son personnage, son texte. Ce sont surtout les plus âgés qui m’ont fascinée, et j’ai beaucoup appris en les regardant.
Ce qui m’intéressait particulièrement, c’était l’art de l’acteur : comment il interprétait le texte, ce qu’il y mettait de personnel. Petit à petit, je me suis retrouvée à diriger les travaux avec mes collègues de l’époque, que ce soit pour des improvisations, des échauffements ou des recherches. C’est de là que j’ai commencé à me former à la mise en scène, en particulier auprès d’Alain Knapp, un metteur en scène et dramaturge qui m’a beaucoup apporté, même s’il est moins évoqué aujourd’hui. Il a été un véritable déclic pour moi, notamment en me montrant comment lier la mise en scène à la dramaturgie.
Au fur et à mesure, j’ai commencé à jouer moins et à mettre en scène davantage. La gestion de la compagnie prend aussi énormément de temps, mais c’est une facette du travail qui me passionne. C’est fascinant de voir comment un projet se monte, avec quels financements, et surtout comment on gère et dépense l’argent pour concrétiser nos idées.

VOUS AVEZ MIS EN SCENE “DES FILLES AUX MAINS JAUNES” DE MICHEL BELLIER, POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS SUR CE PROJET ?
Avec Michel, nous avons un compagnonnage très long. On s’est rencontrés jeunes, dans les années 80, en tant qu’acteurs. On faisait partie d’une aventure collective, un groupe d’acteurs qui travaillait autour de l’improvisation, du corps et de l’espace. À cette époque, Michel commençait déjà à s’essayer à l’écriture. Depuis, on ne s’est jamais perdu de vue, c’est un des plus anciens compagnons de route.
“Les filles aux mains jaunes” a été créé par Dynamo en 2014 et joué jusqu’en 2018. Un parallèle parfait avec cette pièce qui parle de la guerre de 14-18, ce n’était pas du tout notre volonté au départ, mais ça s’est imposé à nous de cette manière. Michel avait travaillé sur cette pièce pendant longtemps, après avoir fait des recherches profondes sur la Première Guerre mondiale, un sujet qui le passionne. Il s’intéressait aussi à l’émancipation féminine au XXe siècle. Depuis le début de la compagnie, nous avions l’idée de retracer le combat des femmes pour leur émancipation, un sujet qu’on avait déjà exploré avec un spectacle sur la migration des femmes en Europe contemporaine, un sujet encore très peu traité.
Michel a poursuivi sa pièce, et très vite, je me suis dit que le sujet était très pertinent pour les jeunes d’aujourd’hui et qu’il fallait absolument qu’on le mette en scène. En 2014, on a créé cette pièce, qui a rencontré un accueil enthousiaste, notamment en Belgique et au Luxembourg, où les producteurs et coproducteurs nous ont soutenus avec beaucoup d’enthousiasme. On a trouvé un écho à notre travail de recherche sur l’émancipation des femmes dans le monde théâtral belge et luxembourgeois. On a joué à Bruxelles au Théâtre Le Public pendant longtemps, puis on a fait une tournée incroyable pendant quatre ans. En 2016, on l’a présenté à Avignon, où ça a vraiment fait un carton. Les gens ont beaucoup aimé et ont redécouvert des choses, notamment les personnes plus âgées, qui avaient connaissance de ces sujets, mais souvent de manière indirecte, par les récits de leurs mères ou grands-mères. Et puis, il y avait aussi les jeunes qui ont découvert la façon dont les femmes étaient traitées à l’époque, c’était assez inédit pour eux.

J’ai eu la chance d’être l’une des premières lectrices de la pièce. Michel me la lisait régulièrement, et il me tenait informée de son évolution. Plus je lisais, plus je me projetais dans le projet. L’histoire m’a passionnée, et je me suis dit que c’était aussi une occasion de revisiter l’histoire du théâtre à travers la guerre de 14-18. Cela nous permettait de parler de la recherche théâtrale du début du XXe siècle, de l’art nouveau, mais aussi de l’art documentaire qui commençait à émerger avec Erwin Piscator en Allemagne. On avait un univers qui nous permettait d’explorer cette période constructiviste, qui résonnait bien avec les enjeux de la guerre de 14-18, et de voir comment les peintres, auteurs et poètes avaient retranscrit la guerre à travers cet art.
Cela m’a aussi permis de me plonger dans des recherches sur cette période, et d’amener un mélange entre scènes dialoguées et narration. Je trouve que Michel est un conteur formidable. Il maîtrise aussi bien l’art du dialogue que celui de la narration, et sa façon de lier les deux dans un travail dramaturgique a beaucoup de souffle, c’est épique.
Je lui ai donc demandé de nous céder les droits de la pièce et de s’associer à nous en tant que dramaturge. C’est comme ça qu’on a commencé à chercher des co-financeurs, et l’aventure a démarré. Ça a été une expérience formidable, un travail intense et joyeux avec les actrices, en particulier autour de la prise de parole de ces femmes. On a beaucoup travaillé sur la rythmique, car il était très important de montrer l’usure et la difficulté du travail. Le corps devait être très présent, avec une partition corporelle et dialoguée assez intense. Cela donnait cette sensation d’étouffement, de temps qui manque constamment pour ces femmes, et la pièce ne laissait quasiment jamais de pause.
On avait deux plans inclinés sur scène, et les actrices faisaient face au public. C’était comme un champ contre-champ au cinéma, où les spectateurs voyaient les protagonistes, parfois les antagonistes, se confronter directement. Le dialogue passait constamment par le public, comme un témoignage direct. C’était une manière de montrer à quel point il était difficile pour ces femmes de communiquer et de créer des liens dans cet environnement hostile, bruyant. Leur manière de se parler tout en travaillant mettait en évidence l’isolement qu’elles subissaient et l’absence de répit dans leur quotidien.

LES TROUPES AMATEURS S’EMPARENT DE PLUS EN PLUS DE CE TEXTE, POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CE TEXTE EST AUTANT POPULAIRE ?
Je pense qu’il y a beaucoup de femmes aujourd’hui qui font du théâtre, mais souvent, elles n’ont pas des rôles à la hauteur de leurs ambitions, de leurs envies, de leurs désirs. Et dans cette pièce, ces quatre femmes sont vraiment des figures quasi héroïques. Michel n’a pas écrit des portraits d’héroïnes, comme on l’entend communément, il montre des destinées de femmes ordinaires, que rien ne prédestinait à affronter le tragique et la violence, et qui vont avoir une prise de conscience de leur condition et des paroles puissantes.
Il y a aussi un contexte historique à prendre en compte. On a envie de revisiter l’histoire de l’émancipation féminine, surtout quand on voit qu’elle est aujourd’hui attaquée. Ce qu’on pensait être acquis, inébranlable, inscrit même dans la constitution, est aujourd’hui menacé. On peut le voir autour de nous, en Europe et ailleurs, avec des attaques contre les droits et l’émancipation des femmes.
Le langage de la pièce est savoureux, c’est une tragédie, mais comme toute tragédie, il y a des moments très forts et drôles. Ce sont des personnalités qui prennent vie, et ça donne beaucoup de profondeur à l’histoire.
Et puis, cette pièce peut aussi être montée par modules, on peut l’adapter. Je pense que c’est ce qui la rend intéressante, notamment pour le théâtre amateur. Elle offre une grande liberté de mise en scène.
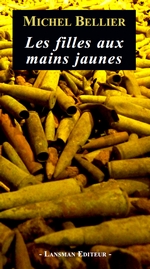
EN CETTE PÉRIODE COMPLIQUÉE QUE TRAVERSE LE MONDE, PENSEZ-VOUS QUE LE THÉÂTRE A UN RÔLE À JOUER ?
Le théâtre a toujours été un reflet de nos sociétés. C’est d’abord une littérature vivante, quelque chose de profondément collectif. En ce sens, il est un peu anachronique aujourd’hui, car on vit dans une époque où la consommation culturelle est devenue très individualiste. Le théâtre, c’est un moment de partage, un lieu où l’on se retrouve sous un même toit, avec des gens que l’on ne connaît pas, pour écouter des histoires. C’est tout un univers qui nécessite le collectif, sinon il perd son sens.
Dans ce contexte, le théâtre reste primordial, mais en même temps, aujourd’hui, je crois que l’audiovisuel, à travers les séries notamment, prend un peu le relais de ce qu’était le théâtre pendant longtemps, dans la manière de raconter des histoires. C’est devenu plus difficile pour le public, surtout la jeunesse, de venir au théâtre. Cela ne fait plus partie de nos habitudes culturelles, ce qui est assez étrange. Le public vieillit, et c’est un vrai défi de redynamiser l’art théâtral pour que cette parole collective se fasse entendre à nouveau.
Pour cela, il faut se pencher sur la narration : comment elle est structurée, quels sont ses objectifs. Est-ce une parole politique, artistique, ou les deux ? Je pense qu’il est essentiel que les jeunes et moins jeunes se réapproprient cet art de la parole, pas forcément à travers un mouvement d’écriture sur le plateau, mais en partant de questions sociétales majeures. Comment se construit l’écriture théâtrale ? Qu’est-ce qu’on y met dedans ?
Il y a mille choses à réinterroger. Il est temps de se réapproprier ce formidable outil, qui est profondément politique, parce qu’il s’immisce directement dans la vie de la société.

QUEL EST VOTRE ACTUALITÉ ?
Cet été à Avignon, nous présenterons deux pièces. La première s’appelle Un toit sur la mer. C’est encore une écriture originale de Michel, qui explore la rencontre entre deux personnes totalement différentes. C’est un choc intergénérationnel, un affrontement de mondes qui doit déboucher sur un dialogue, une rencontre qui pourrait même transformer leur vie. Cette pièce sera jouée au Théâtre du Girasol, à 17h30, du 5 au 26 juillet.
La deuxième création est un solo que j’interprète, dans une partition un peu clownesque, mais qui aborde aussi une question sociétale majeure : le réchauffement climatique. Avec Michel, nous avons voulu l’inscrire dans une fiction presque apocalyptique, futuriste. Nous sommes après 2050, la planète est dévastée, et il ne reste qu’une vieille femme qui lutte pour maintenir le monde à flot avec des réflexions à la fois profondes et cocasses. Ce spectacle sera joué au Théâtre du Petit Chien, tous les jours à 20h45, du 5 au 26 juillet.
En parallèle, nous poursuivons notre travail sur les écritures contemporaines francophones. À travers des résidences d’écriture, nous continuons d’explorer cette question, en y intégrant des réflexions sociologiques sur l’évolution de l’écriture théâtrale francophone d’aujourd’hui.
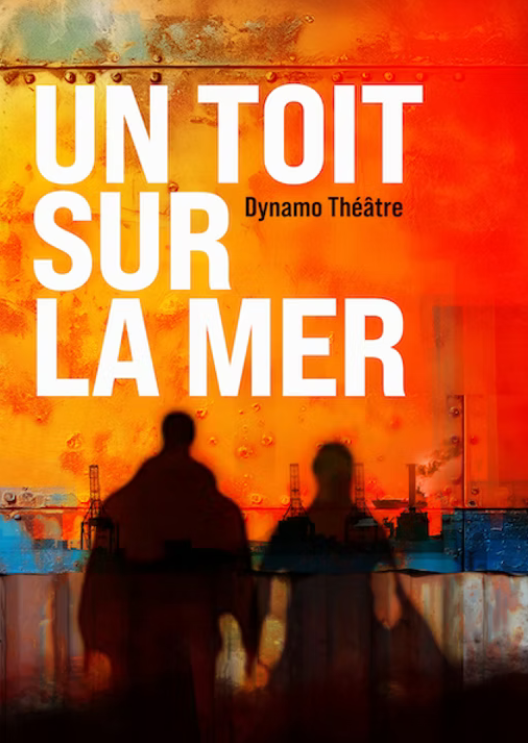
UN MOT POUR TERMINER ?
Je souhaite une longue vie au théâtre, et au théâtre amateur, qui est notre origine à Michel et à moi, avant même que nous poursuivions nos études théâtrales.
Complétez votre lecture avec les interviews de Michel Bellier et Émile Lansman.

